abroad
premiere
Daniele Ghisi
Outline
action
Updated at
Vous constatez une erreur ?
The setup and the execution of the electroacoustic part of this work requires a Computer Music Designer (Max expert).
Version Information
- Performance date
- 15 juin 2011
- Documentation date
- 6 juillet 2011
- Version
- premiere
- Status
- valid
- Validation date
- 6 juin 2018
- Documentalist
- Daniele Ghisi (ghisi@ircam.fr)
- Realisation
- Daniele Ghisi (Computer Music Designer)
- Length
- 28 min
Other Versions
2016?documented11 février 2020
Detailed Staff
- Soloist
- solo soprano
flute, clarinet, piano, violin, cello, trumpet, percussionist, viola
Detailed staff comes from Brahms, send mail to ressources-contenus@ircam.fr for correction.
Electronic Equipment List
Computer Music Equipment
- 1 BCF 2000
- MIDI Mixer (Behringer)
- 1 Max 5
- Max (Cycling74)
- 1 Macintosh
- Apple Desktops (Apple)
Audio Equipment
- 1 DM1000
- Digital Mixers (Yamaha)
- 8 e12
- Passive Monitors (d&b audiotechnik)
- 8 e8
- Passive Monitors (d&b audiotechnik)
Downloads
abroad_stereo_320kbps.zip
Daniele Ghisi
commentaire
recording (good mp3 quality), mix of general rehearsal and première; use it as a reference for technical troubles
68.28 Mo
FrontalPlan.png
127.87 Ko
BasicScheme.png
40.51 Ko
UpPlan.png
201.21 Ko
StagePlan.png
173.41 Ko
PatchScreenshot.png
192.16 Ko
Instructions
The electronic part of the piece is a patch for MaxMSP 5, which is in the all-in-one zip archive. All the libraries and files needed for the piece are in the Libraries folder, the abstractions in the Abstractions folder. For any problem whatsoever, don’t hesitate to contact the composer at danieleghisi@gmail.com).
Amplification on ALL instruments has to be planned, in addition (and independently) to the electronic patch. The amplification should be frontal (loudspeakers 1 and 3, in the following scheme, or similar placements), and may (should) vary throughout the 7 Lieder.
Please read the _Readme.pdf that you find in the all-in-one zip file for more information. For any doubt, always refer to that _Readme file.
VERY IMPORTANT: due to a small bug which will be solved later, the "Raise all faders" button in the to do list of the patch DOESN'T raise the voice dpa fader. Thus it is extremely important to raise it by hand (0 dB) before the beginning of the piece!
Microphones
Microphone setup for the première (and choice of microphones:)
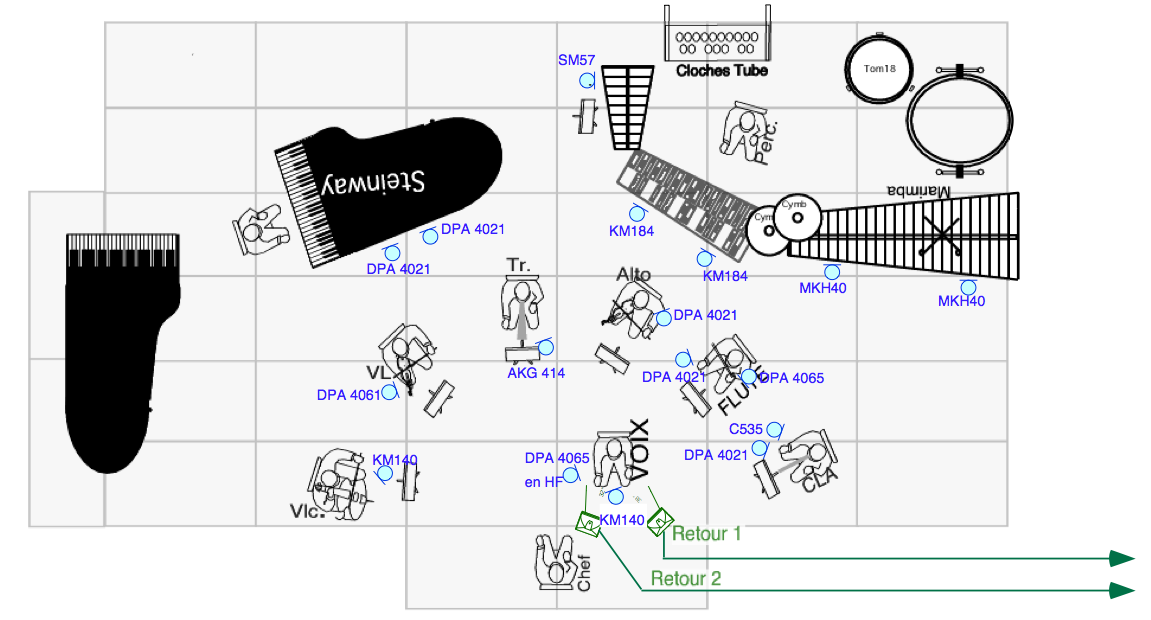
Loudspeaker setup
Loudspeakers disposition for the performance:
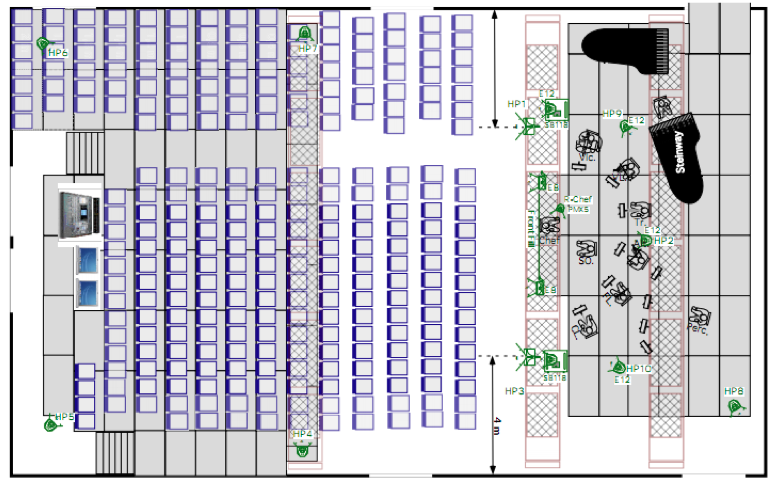
Vertical section:
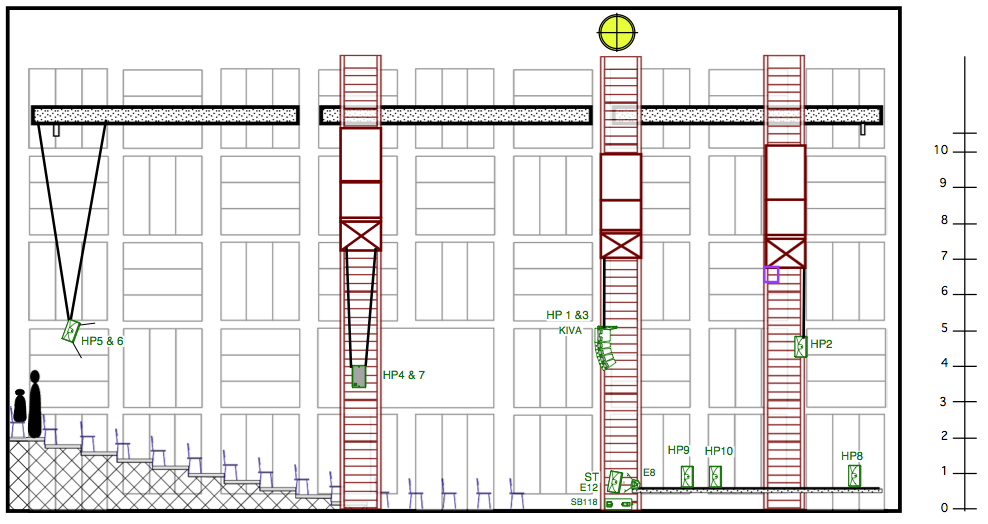
Basic scheme:
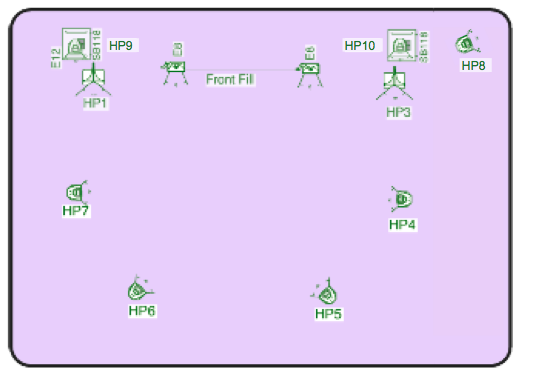
Midi setup
Only a BCF is needed (linked to the main computer). The first 7 faders have to be mapped to controllers 1 to 7 (channel 1).
Software installation
Open MaxMsp5. Check the DSP status and choose the desired soundcard. Add the Abstractions folder and the Libraries folder (that you find in the concert patch folder, which is the all-in-one big zip archive) to your Max5 libraries folder, via the menu: Options > File preferences >> Add...
These two folders contain all the libraries, externals and abstractions needed by patch. If you have only the Runtime version of Max5, you have to put all this folder in the Max 5 Runtime folder (applications), if it doesn't work you can put it in the msp-externals folder.
Finally, open the main patch abroad.maxpat.
Please read the _Readme.pdf file for more information.
System calibration and tests
A simulation is included in the patch. In order to run the simulation of a given Lied, just choose the Lied number in the Simulation panel (in the main patch window), and then click on the Play button. The playbar allows you to jump somewhere in the simulation. Some shortcuts are prepared for you: you find them in the Simulation panel as well. You always have to choose the right Lied in the menu before clicking on a shortcut. Those shortcuts just play the active Lied starting from the written cue.
Please notice that the cues of lied (v), only concerning the “real” piano, stop after being played. This is peculiar, so you should trigger each cue separately at the needed moments in the score.
Often a precise synchronicity between the event triggering and the simulation is required, and sometimes (rarely!) this cannot be achieved by the pure listening of the simulation – think at the very first event: the simulation must enter precisely 4 beats after the triggering of the event! In these cases, some outbeat-clicks are given INSIDE the simulation, in order to help you triggering the events properly. Namely, this is the case of: Lied 1 Event 1 (“There Is”), Lied 3 Event 1 (“FromMyVilla”), Lied 4 Event 11 (“Abroad”). In these cases, the out-beats/triggering sequence is the following one:
[outbeat - outbeat - trigger!]
Initialization routine
Follow all the to-do list you find on the left side of the patch.
Patch presentation
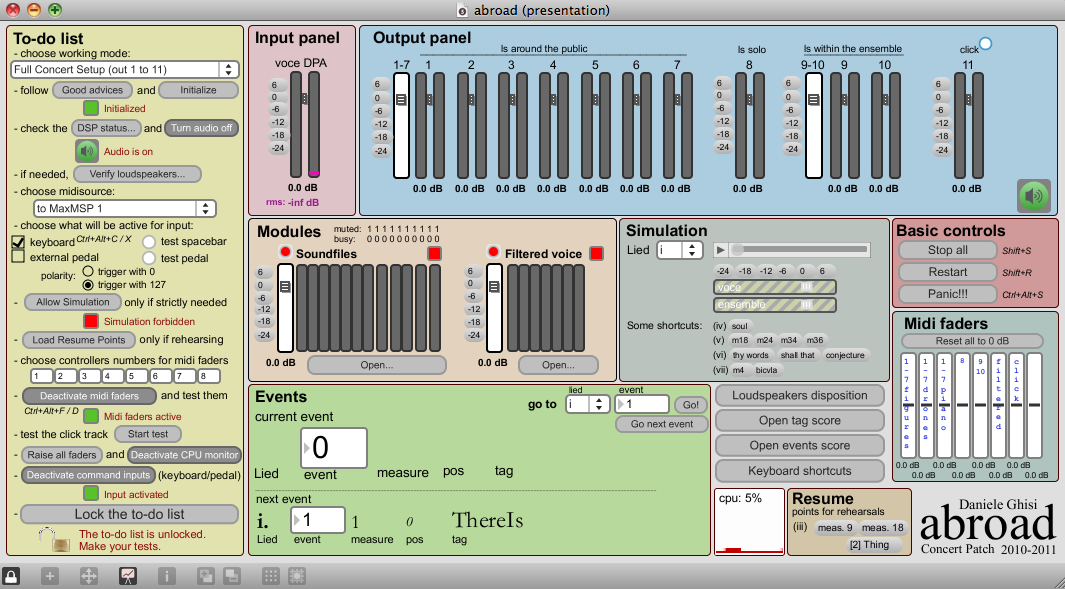
Performance notes
Please, check the _Readme.pdf file, section "E - important things to know", to have some performance notes!
Updated at
Vous constatez une erreur ?
IRCAM
1, place Igor-Stravinsky
75004 Paris
+33 1 44 78 48 43
heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Fermé le samedi et le dimanche
accès en transports
Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles
Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique
Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.